Quelle que soit l'étrangeté de certaines pratiques animales, ce sont encore les hommes qui ont la sexualité la plus bizarre...
Sans doute faut-il être biologiste pour se demander « pourquoi l'amour est un plaisir ». La plupart de ses pratiquants se contentent de l'éprouver le plus souvent possible, sans trop se poser de questions - du moins sur le moment. Car, bien sûr, par « amour » il faut entendre celui qu'on « fait » : « sex » en anglais (« Why is sex fun ? ») et non l'amour-passion, dont les joies peuvent, à l'occasion, se muer en douloureux tourments - surtout s'il n'est pas partagé.
Donc Jared Diamond, étant biologiste, s'interroge, admiratif qu'il est de la diversité des moeurs sexuelles qu'il observe dans le règne animal.
Il est, en effet, des espèces où l'amour est peut-être un plaisir, mais bref. Du moins pour le mâle qui, chez certaines araignées comme chez les mantes (évidemment religieuses), est systématiquement dévoré par la femelle durant l'accouplement. Et Diamond de préciser, avec gourmandise, que « ce cannibalisme a clairement le consentement du mâle, car il aborde la femelle, ne tente pas de fuir et va même parfois jusqu'à incliner sa tête et son thorax vers la bouche de sa partenaire pour permettre à celle-ci de le grignoter par petits bouts, tout en épargnant l'abdomen qui achève de lui injecter son sperme ».
Apparemment plus soucieuses d'un plaisir durablement partagé, les souris marsupiales, en revanche, préfèrent prolonger leur accouplement, sans faiblir, durant une douzaine d'heures, tandis que les chimpanzés pygmées, dits bonobos, optent pour le coïtus repetitus : jusqu'à sept ou huit fois par jour. Soit deux formes de libertinage que semblent rejeter - l'on n'ose dire vertueusement, par crainte d'anthropomorphisme moralisateur - leurs plus grands cousins simiens : les gibbons, par exemple, qui forment des couples monogames, mais restent des années sans faire l'amour, ce qui ne témoigne guère en faveur des joies du mariage. Il est vrai que les gorilles qui, eux, sont polygynes - c'est-à-dire se constituent un harem - ne s'unissent à l'une ou l'autre de leurs femelles qu'en de rares occasions par an : ce qui ferait de leur harem, aux yeux du moindre prince oriental normalement constitué, un luxe fort inutile.
Un petit harem de deux mâles.
Et pourtant, de l'éléphant de mer au gobe-mouches noir, quelle que soit l'étrangeté de certaines pratiques, c'est encore nous, assure Jared Diamond, qui sommes les plus « bizarres ». Car notre espèce est la seule - et notamment parmi les mammifères - à conjuguer une série de caractéristiques où l'on peut voir la « norme » de la sexualité humaine : ce qui n'exclut pas, bien entendu, diverses violations de cette norme - laquelle se trouve d'ailleurs confirmée par ces violations mêmes. Ces traits singuliers, qui font la « bizarrerie » de notre sexualité, Jared Diamond les résume, pour l'essentiel, en six points :
- La plupart des hommes et des femmes, dans la plupart des sociétés humaines, vivent un jour ou l'autre dans une relation à deux durable (mariage) que les autres membres de la société reconnaissent comme un contrat impliquant des obligations mutuelles. Chaque partenaire du couple a des rapports sexuels répétés, surtout ou exclusivement avec l'autre.
- En plus d'être une union sexuelle, le mariage est un partenariat qui vise à élever en commun les enfants qui en résultent. D'ordinaire, les mâles humains participent aux soins parentaux au même titre que les femelles.
- Quoique formant un couple (ou parfois un harem), un mari et une femme (ou des femmes) ne vivent pas (comme les gibbons) en couples solitaires, sur un territoire exclusif qu'ils défendent contre d'autres couples. Ils vivent en société, parmi d'autres couples avec qui ils coopèrent économiquement en partageant le territoire commun.
- Les partenaires d'un mariage font d'habitude l'amour dans l'intimité au lieu d'admettre, avec indifférence, la présence d'autres êtres humains.
- L'ovulation, dans l'espèce humaine, est dissimulée plutôt qu'affichée. C'est-à-dire que la brève période de fertilité des femmes, au moment de l'ovulation, est difficile à détecter pour leurs partenaires sexuels potentiels, aussi bien que pour la plupart des femmes elles-mêmes. La réceptivité sexuelle d'une femme s'étend bien au-delà de sa période fertile, pour englober jusqu'à la totalité de son cycle menstruel. Ainsi, la plupart des accouplements humains se produisent à des moments impropres à la conception. Ce qui signifie que la sexualité humaine vise davantage au plaisir qu'à l'insémination.
- Toutes les femmes qui dépassent quarante ou cinquante ans subissent la ménopause : une interruption complète de la fertilité. Ce n'est pas le cas des hommes : bien qu'ils puissent connaître à tout âge des problèmes de fertilité, il n'y a pas d'âge pour de tels problèmes, ni de totale et générale interruption.
Certes, convient Jared Diamond, chacun de ces traits, pris isolément, n'est pas spécifique de l'humanité. Comme nous, par exemple, on l'a dit, les gibbons vivent en couples. Comme la plupart des hommes, le zèbre mâle prend soin de sa progéniture. De même chez les tamarins, où la femelle, prudente, se compose d'ailleurs un petit harem de deux mâles. La sexualité publique de la presque totalité des animaux connaît elle-même des exceptions : notamment chez les chimpanzés où un mâle et une femelle partent s'isoler durant quelques jours. Enfin les dauphins, comme les bonobos, se livrent, hors de tout souci de procréation, à une sexualité ludique qui n'a rien à envier, semble-t-il, à celle des humains.
Des attributs modestes.
Pourtant, insiste le biologiste, l'espèce humaine est la seule qui présente à la fois toutes ces conduites. Or nous ne sommes pas un mélange de dauphin, de zèbre et de gibbon. À quoi nous ajoutons d'ailleurs deux curiosités anatomiques qui semblent intriguer Jared Diamond : les hommes n'allaitent pas leurs petits, alors qu'avec un peu de bonne volonté (physiologique), ils seraient capables de le faire ; et leur pénis est d'une longueur disproportionnée à leur corps, par comparaison avec leurs cousins simiens. Ce qui, soit dit en passant, eût dû achever d'instruire Scott Fitzgerald à qui Hemingway, lui faisant visiter le Louvre, devait souligner la discrétion des attributs virils des statues grecques pour le rassurer sur la modestie des siens.
Pourquoi donc, revenons-y, sommes-nous si bizarres ? Pourquoi le sommes-nous devenus, relativement, aussi vite, puisque nous n'avons commencé à diverger qu'assez tard - à l'échelle de l'évolution des espèces - du tronc commun des anthropoïdes : quatorze millions d'années des ancêtres des orangs-outangs, neuf millions de ceux des gorilles et sept millions seulement de ceux des chimpanzés et des bonobos. Et notre « anomalie » est d'autant plus spectaculaire que notre patrimoine génétique ne diffère que de 1,6 % de celui de ces derniers, de 2,3 % de celui des gorilles.
Des étreintes sans angoisse.
La réponse, Jared Diamond la cherche dans le mécanisme de l'évolution dont il voit le moteur dans une « stratégie » de l'espèce qui vise à optimiser à tout prix la transmission des gènes : donc à en multiplier les occasions et, si elles sont rares, à les utiliser au maximum. Ainsi s'explique, notamment, la chance qu'ont les mâles humains de n'être pas - comme ceux des mantes - dévorés pendant l'amour par leurs femelles. Car le cannibalisme, chez ces dernières, n'est rien d'autre, pour le biologiste, que le moyen le plus efficace de perpétuer l'espèce dans les conditions où celle-ci se trouve.
Dans le cas des mantes, à population raréfiée, le mâle a peu d'occasions dans sa vie de rencontrer une femelle. Quand cela lui arrive, il s'efforce donc d'en tirer, génétiquement, le meilleur profit en produisant autant de descendants que possible. Or, plus la femelle a de réserves alimentaires, plus elle a de calories qu'elle pourra convertir en oeufs. Dès lors, en se laissant dévorer, le mâle s'assure qu'elle engendrera un plus grand nombre d'enfants. Bref, il se suicide pour mieux propager ses gènes. Il s'immole pour le salut et la grandeur de sa lignée.
Dans l'espèce humaine, heureusement, cet héroïsme digne de l'antique n'a pas lieu d'être. « La plupart des hommes ont, dans leur vie, plus d'une occasion de s'accoupler ; même les femmes bien nourries ne donnent généralement naissance qu'à un seul enfant, ou tout au plus à des jumeaux ; en outre, une femme ne pourrait consommer en une fois une portion suffisante du corps de l'homme pour améliorer de façon significative les facteurs nutritionnels de sa grossesse. » Ainsi le mâle humain, à la différence de ses malheureux confrères de l'espèce araignée, peut-il s'abandonner sans angoisse aux étreintes qu'inspire une passion dite parfois dévorante, mais à titre résolument métaphorique.
De cet exemple, entre bien d'autres, Jared Diamond tire une observation générale : au cours des sept derniers millions d'années, notre anatomie sexuelle a quelque peu divergé, notre physiologie sexuelle un peu plus et notre comportement sexuel plus encore de ceux de nos plus proches cousins, les chimpanzés. Ces divergences correspondent à d'autres divergences touchant l'environnement et le mode de vie de chaque espèce, tout en restant, nécessairement, limitées par des contraintes héréditaires. Mais où est l'effet, où est la cause ? À ce point, notre biologiste rappelle que les paléontologues attribuent d'ordinaire les traits caractéristiques des sociétés humaines (culture, langage et écriture, relations familiales, maîtrise du feu et des outils) au développement de notre cerveau, lui-même facilité par l'adoption de la station verticale. Or, soutient-il audacieusement, notre bizarre sexualité ne fut pas moins essentielle à cette remarquable évolution : celle qui nous a rendus capables « d'acheter ou de cultiver l'essentiel de notre nourriture, d'occuper tous les continents et les océans, d'enfermer dans des cages des membres de notre espèce ou d'autres espèces, d'exterminer toujours davantage la plupart des autres espèces animales et végétales, alors que les grands singes, sans rien dire, continuent de cueillir des fruits sauvages dans la jungle, occupent de petits domaines dans les tropiques de l'Ancien Monde, ne mettent pas d'animaux en cage et ne menacent l'existence d'aucune autre espèce ». Car, poursuit-il, on ne voit pas bien comment notre maîtrise du feu, par exemple, aurait pu favoriser, notamment, le phénomène de la ménopause. D'où l'hypothèse inverse : « L'amour ludique et la ménopause furent aussi importants pour notre conquête du feu, notre acquisition du langage, de l'art et de l'écriture, que notre station verticale et le développement de notre cerveau. »
Qui s'occupera du bébé ?
Soit la tendance majoritaire des êtres humains à constituer des couples plus ou moins stables dans lesquels l'homme participe (plus ou moins) à l'entretien et à l'élevage de sa progéniture. Si les girafes s'intéressaient à nos moeurs, cela leur semblerait très étrange - la seule préoccupation du mâle, après avoir inséminé une femelle, étant de courir en chercher d'autres pour les féconder. Comportement d'ailleurs fort répandu dans la plupart des espèces, avec quelques notables exceptions : chez les oiseaux phalaropes, en particulier, comme chez les crapauds accoucheurs, c'est le mâle qui couve les oeufs pendant que la mère, volage, va à la chasse d'autres mâles.
En fait, estime Jared Diamond, c'est « l'intérêt évolutif » qui commande et conduit à un « choix » en deux temps - ce terme de « choix » ne devant évidemment pas être compris comme une décision consciente de l'individu, mais comme une détermination instinctive programmée, pour le bien de l'espèce, dans l'anatomie et la physiologie.
Donc, premier temps : faut-il s'occuper de l'oeuf (ou de l'enfant) ? Si cet oeuf (ou cet enfant), abandonné à lui-même, avait une bonne chance de survivre et d'arriver sans trop de mal à l'âge adulte, et si ses parents, pendant ce temps, pouvaient se divertir à en produire d'autres en s'accouplant à nouveau entre eux ou avec d'autres partenaires, l'intérêt de l'espèce les inciterait à laisser l'oeuf se débrouiller tout seul. Si, en revanche, l'oeuf pondu ou le bébé qui vient de naître a impérativement besoin d'assistance, un second choix s'impose.
Deuxième temps : qui va s'en occuper ? Le père ? La mère ? Ou tous les deux, dans des proportions éventuellement différentes ? Ce cas est celui des humains, comme celui de tous les mammifères et même des oiseaux - sauf, on ne sait trop pourquoi, les dindons. Dans toutes ces espèces, un oeuf est incapable de survivre par ses propres moyens. En ce qui nous concerne : « L'autonomie du petit de l'homme est particulièrement tardive, ce qui rend indispensable une prise en charge parentale. La seule question est de savoir lequel des deux parents s'en chargera, à moins qu'ils ne l'assument tous les deux. »
Ici, expose Diamond, trois facteurs, pour l'essentiel, entrent en jeu. Premier facteur : ce qu'il appelle « l'investissement initial » de chacun des deux parents. Plus cet investissement est important, moins l'intéressé sera porté à se désintéresser du résultat, c'est-à-dire à négliger sa progéniture. Deuxième facteur : l'importance des occasions perdues par le parent qui décide de se consacrer à ses enfants. S'il n'a rien de mieux à faire, le coresponsable de la naissance se transformera en parent attentionné. Si, en revanche, l'un des géniteurs est vite disponible pour d'autres accouplements productifs, il peut cyniquement « choisir » d'aller multiplier ailleurs ses descendants en laissant son (ou sa) partenaire, voire ses partenaires successifs, se charger des tâches ingrates et méritantes de l'élevage. Troisième facteur : le degré de certitude que peut avoir l'un des parents - le mâle, en l'occurrence, pour les espèces à fécondation interne - d'avoir engendré le petit. S'il nourrit quelque doute, il peut hésiter à trop se dévouer pour élever l'enfant d'un autre... Excellent prétexte pour aller copuler ailleurs - non sans continuer de cultiver la même douloureuse incertitude.
On aura déjà deviné le rôle que jouent ces trois facteurs dans le développement de la sexualité humaine. Le premier - l'investissement initial - est évidemment bien plus important pour la mère que pour le père. « Après la fécondation, la mère est astreinte à neuf mois de dépenses en temps et en énergie, suivis d'une période d'allaitement qui durait environ quatre ans dans les sociétés fondées sur la chasse et la cueillette : mode de vie qui caractérisait toutes les sociétés humaines jusqu'à l'invention de l'agriculture, il y a dix mille ans. » Le deuxième facteur - la perte d'autres occasions de se reproduire - joue également au détriment de la femme.
Jeune Afrique 8 juin 1999 par MARCEL PÉJU.
mardi, juin 12, 2007
Pourquoi l'amour est un plaisir ?
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
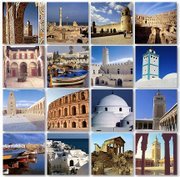












1 commentaire:
Non seulement nous sommes particuliers dans nos rapports sexuels, mais en plus, notre façon de nous aimer ne mène pas toujours à une fécondation sure... Ce qui mène vraiment à penser que pour les humains, c'est (ou c'est devenu) plus un plaisir qu'autre chose...
Enregistrer un commentaire